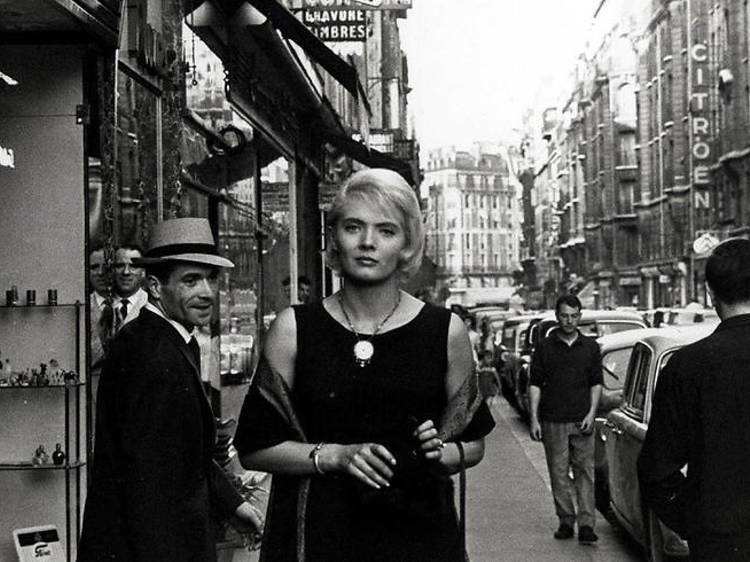1. Le Parrain (1972)


De Francis Ford Coppola, avec Marlon Brando, Al Pacino, Diane Keaton et James Caan
Ah, replonger dans les torpeurs et les fièvres de la famille Corleone... Plus subtil que Les Affranchis, presque moins sanglant que Scarface, le chef-d'œuvre de Coppola offre au public une saga ultra-violente où l’on suit une mafia italienne en pleine perte de contrôle face à un marché noir qui la dépasse. Les codes d'antan s'usent, désormais caducs. L’ancien respect entre les familles est bafoué, doublé par la progéniture du Parrain (Marlon Brando), elle-même motivée par la vengeance immédiate. Seul Michael (Al Pacino) sort du lot. Celui que l'on a écarté de tout le système, et qui ne se destinait pas à embrasser cette carrière trop particulière, se retrouve pourtant bientôt les mains plongées dedans. Le Parrain est un film qui parle d'hier et d'aujourd'hui, de l'usure d'une passation des pouvoirs entre les membres d'un clan que tout finit par séparer. Une intrigue digne des Médicis et l’un des plus grands films américains jamais réalisés.